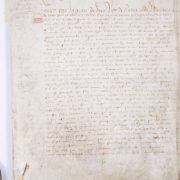Bériac, (Françoise), histoire des lépreux au Moyen Age. Une société d’exclus, Paris, 1988, 279p, Imago.
Françoise Bériac est professeur d’histoire médiévale à l’université Michel de Montaigne-Bordeaux III.
Ouvrage de synthèse (avec références à beaucoup d’études inédites ou peu accessibles) sur la lèpre, les lépreux et les léproseries, alors que les livres antérieurs sur le sujet traitaient plutôt les aspects juridiques et institutionnels (J. Imbert par exemple). Le livre dresse un bilan essentiellement à partir des sources écrites. La tranche chronologique privilégiée ici est comprise entre 1050 et 1350, le moyen âge central donc, avec toutes ses transformations démographiques, économiques, urbaines, sociales…, qui correspond avec la période du plus fort endémisme de la maladie en Occident (la lèpre est endémique en Europe dès les premiers siècles de notre ère, ce n’est pas un résidu des croisades comme l’affirmaient Voltaire et Michelet). C’est pendant cette période que le pauvre ladre devient une figure familière à l’esprit des chrétiens, que la connaissance médicale se renouvelle et que les maladreries prolifèrent.
Dans la première partie, sont examinées les questions relatives à la médecine théorique avec d’abord une présentation succincte des connaissances actuelles sur la lèpre et sur les deux formes médiévales de la lèpre (lépromateuse & tuberculoïde). Ensuite, en suivant l’ordre d’exposition des traités médiévaux sont examinées les différentes causes de la maladie, sa description, son diagnostique.
Si les causes premières ne posent pas trop de problèmes aux savants médiévaux (déséquilibre des humeurs), l’étiologie de la maladie se fait plus complexe avec le temps. Les causes secondaires sont en général moins nettes, elles sont sujettes à de multiples controverses. On distingue l’infection avant la naissance (contamination par la semence de parents atteints ; problème de la conception menstruelle ; contamination vénérienne des lépreux) et après celle-ci (contamination par inhalation d’émanations malignes), mais d’autres invoquent aussi des causes diététiques (et recommandent donc d’éviter les aliments mélancoliques tels le lion, l’âne, l’ours ; les abus d’ail et de poivre aussi, etc).
La description clinique de la lèpre s’affine entre la XIe et le XIIIe siècle, ainsi les symptômes neurologiques sont intégrés, on arrive à une meilleure approximation des quatre formes de la lèpre, mais les progrès réalisés sont insuffisants et souvent erronés tant la répétition des bons auteurs prime sur l’observation originale. Cependant la description clinique atteint au XIIIe un optimum pas dépassé avant longtemps.
Les diagnostiques de la lèpre, toujours tardifs, ne sont jamais fiables au moyen âge, en la matière l’incertitude et la prudence prévalent tellement il faut être certains de son pronostique, mais les risques d’erreurs sont possibles. Dans la pratique, au moins jusqu’au XIIIe, se sont les ladres eux-mêmes qui rendent ces diagnostiques, les diagnostiques médicaux-chirurgicaux s’imposant pendant la période de reflux de la lèpre. Les jurys qui ont à se prononcer sur ces diagnostiques sont en général composé de deux personnes, qui délibèrent, prennent des avis extérieurs avant de donner leur décision. Il semble qu’ils suivent les prescriptions universitaires. Avant que les médecins ne s’imposent on ne sait pas selon quels critères opéraient les ladres (peut être tradition empirique transmise par les grandes léproseries et irréductible à la seule symptomatologie savante).
Au total même les clercs ayant une culture médicale réagissent en chrétiens face à la lèpre durant la période 1050-1350. Toutes les maladies ont des connotations symbolico-religieuses. Elles éprouvent les corps pour le salut des âmes or la lèpre, maladie réputée incurable, est le signe par excellence du péché. Dès que le diagnostique est posé, le lépreux est écarté de la société, "hors du miracle, leur espoir n’est pas dans la guérison du corps, mais dans le salut de l’âme ". Ces problèmes de représentation, l’image de la lèpre, sont examinés dans la deuxième partie. Les idées médiévales et les textes médicaux sur la lèpre viennent d’abord des Ecritures et des Pères (occidentaux surtout : Ambroise, Jérôme, Augustin, Isidore de Séville) mais d’autres thèmes vont modifier cette représentation telles la légende de Constantin, l’histoire de Job, de Lazare…ainsi, si au départ la lèpre est l’allégorie du péché, sa signification se charge d’autres sens contradictoires : rappel des souffrances du christ, appel à la conversion. Aux XI et XIIe siècle devient de plus en plus un thème de réflexion théologique, de prédication, de représentation iconographique, on voit fleurir les personnages de lépreux dans les textes profanes aussi bien que sacrés. Au XIV et XV si l’intérêt demeure, le motif littéraire s’émousse. A noter aussi, l’apparition en 1321 d’un thème nouveau qui provoque "une bouffée de férocité " : le fantasme du complot des lépreux qui empoisonnent les puits… Pendant le XI et le XII, la maladrerie devient un élément ordinaire autour des villes ou des grosses bourgades, alors qu’auparavant on en comptait peu. La période est donc marquée par une multiplications des léproseries et l’apparition d’un type nouveau de léproseries : les fraternités de lépreux. L’auteur place ce mouvement dans le contexte plus large de la montée de l’assistance mais tient à bien distinguer les léproseries des hôpitaux ou des asiles. Les lépreux sont condamnés à rester des mois voire des années dans leur maladrerie, alors que les autres malades ou les pauvres ne font que passer dans les hôpitaux. Cette prolifération attestée (dans le courant du XIIe) se fait sous une forme anarchique. Pour schématiser, la fondation d’une léproserie a lieu quand une personne morale (chapitre, ville…) donne à un groupe de lépreux préexistant, un emplacement où s’installer ou encore quand on dote un groupe de malades de moines chargés de leur prodiguer les soins spirituels. Beriac souligne la fréquente et relative inconsistance institutionnelle des léproseries qui expliquerait en partie leur instabilité. Les œuvres de miséricorde à l’égard des lépreux traduisent les liens et les solidarités sociales entre frères chrétiens plus vivement vécus que par le passé à la fois en raison de la poussée de l’endémie et de l’insuffisance des structures familiales et seigneuriales à assurer la prise en charge des malades. L ‘ apparition d’aspirations communautaires dans les milieux d’exclus, la formation de société en marge de la société apparaît comme le reflet et le complément des transformations de cette période centrale du moyen âge, les lépreux servent de repoussoir identificateur à une société en pleine mutation. Au XIIIe, les maladreries sont devenues assez puissantes pour la constitution de leur temporel se fassent plus par achats que par donation.
La ségrégation des lépreux : à l’époque de floraison des léproseries, on ne conserve pas de texte juridique organisant l’exclusion des lépreux. La ségrégation est d’abord une pratique de fait. Pendant longtemps les seules mesures de polices sanitaires contre ce fléau se limitent à : résidence à l’écart des agglomérations (mais les lépreux ont tout loisir de s’approcher des villes, pour y venir mendier par exemple) ; empêcher la procréation des malades (la stricte continence est recommandée, des sanctions sévères punissent la luxure, mais les léproseries sont mixtes) ; limitation au maximum des contacts directs(ségrégation entre malades et personnels sains dans les maladreries) ou indirects (par la vaisselle, la nourriture, l’eau…) avec les malades. Il semble donc qu’en dépit de réglementations variables, la mise à l’écart des malades se fait de façon de plus en plus vétilleuse et la réglementation de plus en plus minutieuse au fil du XIIIe. Les précautions préconisées contre la lèpre dépassent le discours médical (cf. les contacts indirects, ou sur la question de la transmission sexuelle et de l’hérédité de la lèpre)et témoignent d’une adhésion forte à des notions sur lesquelles la médecine n’insiste pas tant. Mais dans la réalité, ce luxe de précautions ne devait pas être aussi bien respecter dans les maladreries pauvres ou rurales, ni dans les simples bordes avec quelques malades. A noter enfin que même au moment de leur optimum, les maladreries ne furent jamais un réseau efficace de réclusion des lépreux, l’errance et la mendicité étaient le lot de beaucoup…
Vie et mort des lépreux :
La séparation :
Une fois reconnu officiellement lépreux, le malade doit quitter la société, sa famille(même si depuis Alexandre III et Grégoire IX les lépreux peuvent rester marié, bien que séparés physiquement de leur conjoint), ses amis, son village et commencer la dernière phase de sa vie au milieu de ses semblables. Cette séparation est l’objet d’une cérémonie (messe puis procession pour accompagner le ladre à sa nouvelle demeure). Entrer en ladrerie est un "déchirement humain et comme au seuil de la mort, il fallait de surcroît régler ses affaires ".
La vie dans les léproseries :
Les léproseries se distinguent des hôpitaux par leur aspect (enclos, clocher, grosses bâtisses, et surtout chapelle articulée au logement des malades), par leur régime interne et par leur direction immédiate ou supérieure. Bien sûr les usages varient selon les régions, et beaucoup d’établissements ont connu plusieurs types d’organisation. Elles connaissent des évolutions communes, notamment la tendance voulue par les ecclésiastiques à contraindre les ladres à la même discipline conventuelle que les soignants (les haitiés), c’est à dire silence, chasteté, respect de la clôture, mais les ladres ne prononcent pas de vœux (une promesse d’obéissance en tient lieu). Une vie très austère en somme où ceux qui dérogent aux règles peuvent évincer. Les ladres avaient ils le choix ou une certaine liberté ? Le libre choix devait être rare tant la sécurité matérielle, la certitude d’être assisté dans l’invalidité, les pressions familiales et sociales sur eux devaient être fortes. L’entrée dans un couvent de lépreux ou dans une fraternité (moins contraignante) "devait être une carte forcée, avec la maladie pour seule vocation religieuse. Cependant les ladres restent des laïques même vivant en communauté (à une époque où les communautés non rattachées à un ordre approuvé sont suspectes). Cet idéal de vie est menacé de l’intérieur quand (à partir de 1300) l’emprise de la collectivité se desserre et que les provendes individuelles réduisent l’égalitarisme des malades et le contraste entre fraternités de lépreux et les autres types de léproseries.
Donc même avec des insuffisances, les léproseries furent un effort pour prendre en charge les malades (matériellement et spirituellement) et non plus seulement les rejeter (comme prescrit dans le Levitique). L’assistance aux ladres s’est banalisé en même temps que l’image de la lèpre évolue, mais c’est une mutation incomplète puisque de nombreux malades ne vivaient que d’aumône.
En conclusion : à partir de la fin du XIIIe la lèpre reflue (lentement avec parfois des reprises), les institutions d’assistance entrent en crise voire en décadence (léproseries et hôpitaux deviennent souvent des bénéfices ecclésiastiques).
Ecrire à son auteur :
Arago21@aol.com